 Le 20 novembre 1944, le 2e bataillon du 6e Régiment de Tirailleurs Marocains, agissant en renforcement de la 1re DB, arrive aux portes de Mulhouse. Les premiers coups de feu sont entendus vers 16 heures. Ils sont rejoints dans la soirée par les blindés du général Caldairou, arrivant de Pfetterhouse et de Kembs. A 20 heures, le groupement Gardy a pris pied sur le canal situé à l’ouest de la gare, mais la nuit interrompt la progression. Les troupes allemandes en profitent pour fortifier leurs positions dans les casernes de la ville.
Le 20 novembre 1944, le 2e bataillon du 6e Régiment de Tirailleurs Marocains, agissant en renforcement de la 1re DB, arrive aux portes de Mulhouse. Les premiers coups de feu sont entendus vers 16 heures. Ils sont rejoints dans la soirée par les blindés du général Caldairou, arrivant de Pfetterhouse et de Kembs. A 20 heures, le groupement Gardy a pris pied sur le canal situé à l’ouest de la gare, mais la nuit interrompt la progression. Les troupes allemandes en profitent pour fortifier leurs positions dans les casernes de la ville.
Le 21 novembre, à partir de 8 heures, les troupes françaises sous le commandement du général de Lattre de Tassigny pénètrent dans Mulhouse.
Ce sont d’abord les tirailleurs, partis du Rebberg, qui prennent la gare à 8 heures. Leur objectif est d’atteindre la caserne Coehorn en passant par la “Hermann Goering Platz“ (place de la République), la “Adolphe Hitler Straße“ (rue du Sauvage), qu’ils atteignent à 10 heures, et l’avenue de Colmar.
L’avance des troupes est retardée par les Mulhousiens, de plus en plus nombreux à descendre dans les rues. Dans son journal, le capitaine Fourrière, qui commande la 6ème compagnie de Tirailleurs Marocains raconte : « Notre progression est ralentie par les Mulhousiens de plus en plus nombreux. Ils nous proposent de faire des prisonniers, ici deux officiers, là un groupe de soldats. Nous nous excusons de ne pouvoir glaner des prisonniers à chaque carrefour, nous répondons que nous devons prendre la caserne Coehorn, que d’autres troupes vont nous suivre et les débarrasseront de leurs hôtes indésirables. Nous sommes même arrêtés par des photographes !».
A midi, la caserne est en vue, mais ce n’est que vers 20 h 30, après plusieurs tentatives et avec l’aide des blindés que le bâtiment central sera pris. Et la caserne ne sera totalement nettoyée que le lendemain à midi. Les Allemands se regroupent dans la caserne Lefèbvre.
Le 23 novembre, c’est la 7ème compagnie de Tirailleurs Marocains, appuyés par des chars, qui est chargée de s’en emparer. Une section a réussi à parvenir dans un bâtiment proche, mais les Allemands contre-attaquent et, pour les dégager, le lieutenant Jean Carrelet de Loisy pénètre avec son char “Austerlitz“ dans la cour de la caserne. Un tir de panzerfaust touche le dessus de la tourelle du char, le lieutenant est tué sur le coup. Mais grâce à cette intervention, les tirailleurs peuvent se dégager.
La prise de la caserne Lefèbvre marquera la fin des combats dans Mulhouse, mais les Allemands tiendront Lutterbach et Bourtzwiller jusqu’à début février 1945.
La promotion 2007-2010 de Saint-Cyr porte le nom de “Promotion Lieutenant Carrelet de Loisy“
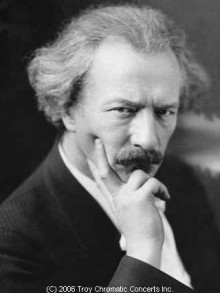 Même s'il n'a fait qu'un cours séjour à Strasbourg, cette personnalité exceptionnelle a toute sa place ici.
Même s'il n'a fait qu'un cours séjour à Strasbourg, cette personnalité exceptionnelle a toute sa place ici.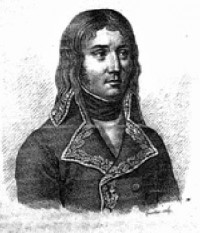 Jean Charles Abbatucci est né le 15 novembre 1771 à Zicavo en Corse.
Jean Charles Abbatucci est né le 15 novembre 1771 à Zicavo en Corse.