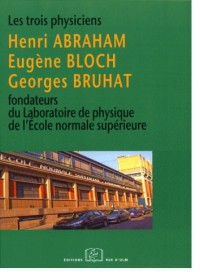 Eugène Bloch est né le 10 juin 1878 à Soultz Haut-Rhin.
Eugène Bloch est né le 10 juin 1878 à Soultz Haut-Rhin.
Pour donner à ses fils une éducation française (l’Alsace est alors allemande), son père vend son usine textile et s’installe à Paris. Eugène Bloch fait ses études à l’École normale supérieure et à la faculté des sciences. Il obtient, en 1899, ses licences en sciences physiques et sciences mathématiques. L’année suivante, il est reçu à l’agrégation de physique et devient préparateur au laboratoire de physique de l’École normale supérieure.
En 1904, il soutient sa thèse de doctorat en sciences physiques sur l’ionisation dans la phosphorescence. En 1906, il est nommé professeur de physique en classe de mathématiques spéciales au lycée Saint-Louis, à Paris, où il enseignera jusqu’en 1921, tout en poursuivant ses travaux de recherches sur l’effet photoélectrique. Cette carrière d’enseignant sera interrompue pendant quatre ans; entre 1914 et 1918, période durant laquelle il est mobilisé et affecté au service des télécommunications militaires. Là, il participe au développement des premiers amplificateurs électroniques pour la réception d’ondes radio et des premiers appareils de mesure précise des fréquences radio.
En 1921, il publie “Les procédés d’enregistrement des signaux de T.S.F“. cette même année il est nommé maître de conférences de physique à l’université de Paris, puis, en 1927 professeur de physique théorique et physique céleste à faculté des sciences. En 1930, il publie “L’ancienne et la nouvelle théorie des quanta“ devenant ainsi l’un des premiers à introduire en France la mécanique quantique. En 1934, il devient président de la Société française de physique, puis, en 1937, directeur du laboratoire de physique de l’École normale supérieure.
Suite aux lois anti juives, il est révoqué et passe clandestinement en zone libre où il travaille, jusqu’en 1942, dans un laboratoire de l’université de Lyon. Après l’invasion de la zone libre par les Allemands, il se réfugie en Savoie sous une fausse identité mais est arrêté le 24 janvier 1944 à Allevard-les-Bains en Isère.
Le 7 mars 1944, il est embarqué dans le convoi N° 693 pour le camp d’extermination d’Auschwitz où il disparaît.
La fondation Eugène Bloch attribue deux prix :
- le prix Eugène et Léon Bloch , accordé à deux lycéens dont les qualités intellectuelles et morales ont été remarquées et arrivant à la fin d’une classe terminale scientifique ou littéraire, l’un à Louis-le-Grand, l’autre à Henri IV;
- Le prix des Trois physiciens morts pour la France (Henri Abraham, Eugène Bloch et Georges Bruhat, fondateurs et directeurs du laboratoire de physique de l’Ecole Normale Supérieure, morts en déportation entre 1940 et 1945), accordé à un physicien.
 Même s’il n’y a vécu que les six premiers mois de sa vie, Michael Gregorio est Mulhousien. C’est dans cette ville qu’il est né le 10 juin 1984 !
Même s’il n’y a vécu que les six premiers mois de sa vie, Michael Gregorio est Mulhousien. C’est dans cette ville qu’il est né le 10 juin 1984 ! Jean-Baptiste Lemire est né le 8 juin 1867 à Colmar. Après l’annexion, sa famille s’installe à Grand-Charmont dans le Doubs, puis à Belfort. A 16 ans, il entre à la Société alsacienne de constructions mécaniques, également expatriée à Belfort. C’est dans la fanfare de cette entreprise qu’il apprend le trombone.
Jean-Baptiste Lemire est né le 8 juin 1867 à Colmar. Après l’annexion, sa famille s’installe à Grand-Charmont dans le Doubs, puis à Belfort. A 16 ans, il entre à la Société alsacienne de constructions mécaniques, également expatriée à Belfort. C’est dans la fanfare de cette entreprise qu’il apprend le trombone.